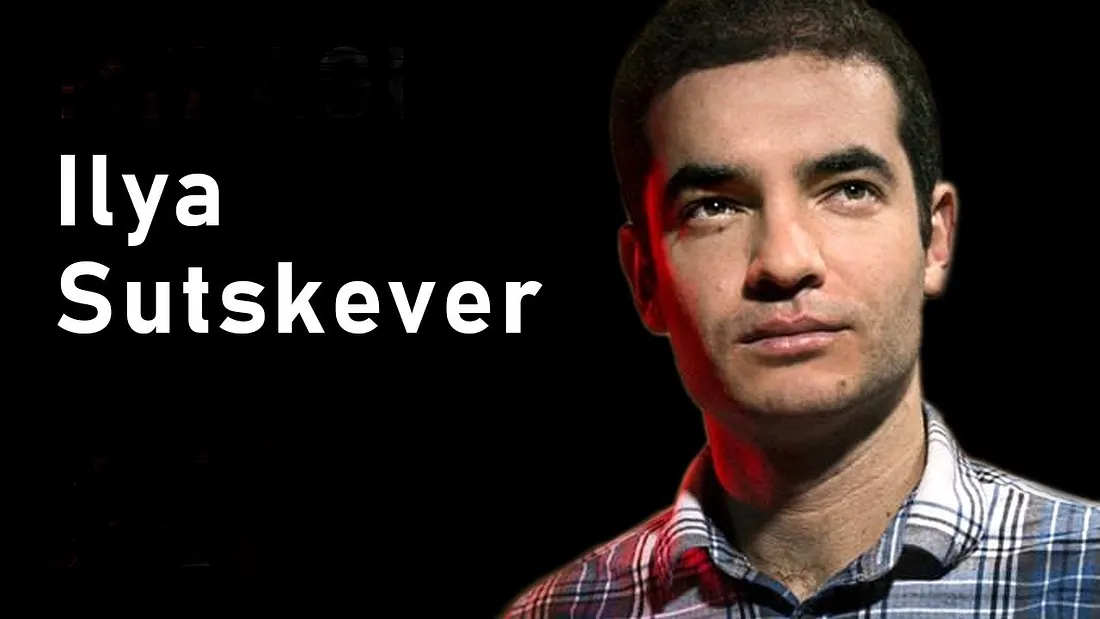La « Silicon Savannah », morceau de Californie high tech au Kenya.

Le minibus est cabossé de partout, comme s’il avait croisé malencontreusement la route d’un rhinocéros, et son moteur toussote : bienvenue en Afrique. C’est pourtant ce véhicule improbable, mille fois ressuscité par des mains expertes, qui m’emmène de l’aéroport de Nairobi au cœur de la « Silicon Savannah », le creuset de l’innovation numérique au Kenya, où chaque jour des start-up trouvent, à coups d’applications mobiles, des solutions à toutes sortes de problèmes : gouvernance politique, insécurité, santé, système bancaire, agriculture, transports, éducation.
On est fin novembre 2014. Cela fait sept mois qu’avec le projet #TECHAfrique je parcours l’Afrique de l’innovation pour rencontrer et faire connaître ces jeunes Africains qui brisent les codes et prennent des risques pour entreprendre. Changer leur vie et améliorer celle de leur communauté grâce au numérique, tel est le credo de ces nouveaux héros.
Au Sénégal, ma première étape, j’ai découvert un écosystème bouillonnant, catalysé par l’entrepreneuriat technologique sous l’impulsion d’espaces d’incubation, comme le CTIC Dakar, ou de coworking, comme Jokkolabs.
Au Ghana, j’ai passé des journées entières dans l’incubateur MEST, où de jeunes développeurs produisent des applications comme Saya, une messagerie instantanée rachetée par un groupe indien basé aux Etats-Unis, ou KudoBuzz, une technologie qui aide les sites à développer leur audience et qui a rejoint le fonds californien 500 startups.
Au Bénin, j’ai découvert TEKXL, un accélérateur qui forme au code une trentaine de jeunes développeurs informatiques. Son cofondateur, Ulrich Sossou, une vingtaine d’années, racontait le chemin parcouru depuis sa première start-up qu’il avait dû créer dans un cybercafé de Porto-Novo, faute de moyens.
Même le Mali, malgré une situation sécuritaire incertaine, accueillera en 2016 à Bamako son premier incubateur ainsi que sa première école de code informatique. Tout cela est surprenant, encourageant, mais un voyage dans la « tech » africaine passe obligatoirement par Nairobi, ville pionnière, l’origine d’innovations qui ont infusé tout le continent.
L’Afrique « Do It Yourself »
Nous roulons toujours. En Europe, ce minibus aurait rejoint la casse il y a longtemps. Mais sur le continent de la résilience et de la débrouillardise, rien ne se perd. Lorsque les puissances industrielles occidentales et asiatiques se débarrassent, via des circuits obscurs, de leurs déchets électroniques, des bataillons de bricoleurs africains passent à l’offensive. Ils transforment ces montagnes de déchets en or numérique et bâtissent, autour de ces décharges qui ensevelissent parfois des quartiers entiers comme Agbogbloshie, au Ghana, des écosystèmes basés sur le recyclage.
Des ordinateurs reviennent à la vie dans des bidons et servent à former des écoliers à l’informatique. Au Togo, c’est une imprimante 3D qui a été construite de toutes pièces à partir de rebuts informatiques, dans un « FabLab » de Lomé où j’ai passé plusieurs semaines, fasciné par l’esquisse, en mode frugal, d’une prochaine révolution industrielle. L’Afrique est bien le continent du « Do It Yourself » et de slogans comme « Si tu veux changer la donne, lève-toi et fais-le toi-même », « Pour et avec la communauté », « Devenir entrepreneur de sa vie, pour hacker le système ».
Un petit morceau de Californie en Afrique
Le minibus arrive enfin au Bishop Magua Centre, sur Ngong Road. C’est là, au quatrième étage d’un bâtiment moderne, que s’épanouit un espace technologique dont le nom est sur toutes les lèvres : iHub, l’antre des lions de la « Silicon Savannah ». Des start-up innovantes par dizaines, des discussions passionnées, de l’électricité dans l’air et très peu de chaises vides, c’est un petit morceau de Californie en terre africaine. Ce jour-là, des entrepreneurs partagent leurs conseils avec une vingtaine d’étudiants, de designers, de free-lance.
J’y retrouve Kenneth, l’associé kényan d’un ami camerounais vivant à Marseille. Ensemble, ils sont en train de monter une start-up au concept prometteur : des ventes groupées s’inspirant du concept asiatique de la tontine mais à la sauce africaine. Kenneth vient travailler tous les jours à iHub, où il donne des formations de « Lean start-up ».
En l’écoutant, je réalise qu’à iHub, les start-up font dans la rupture. Ou dans la « disruption », pour reprendre un anglicisme. Mais que peut-on bien vouloir « disrupter » à Nairobi, en 2015 ? J’ai droit à quelques exemples : faire disparaître des millions de lampes au kérosène, polluantes et dangereuses, au profit de l’énergie solaire payée à l’heure via SMS avec l’application M-Kopa.
Ou livrer des colis par moto guidée par GPS dans des rues non répertoriées par les cartes et délabrées par la saison des pluies, un projet de la start-up Sendy. Ou encore offrir un adressage postal à des millions de Kényans qui n’ont jamais eu d’adresse, avec la jeune société OkHi. Les problèmes de ce type ont freiné durant des décennies le développement de l’Afrique. Pour en venir à bout, il faut un appétit de lion.
De tous les espaces technologiques africains, iHub est celui dont l’histoire est la plus symbolique. Fin 2007, le pays se fracture après l’élection présidentielle. Un bilan, en février 2008, fait état de 1 500 morts et 300 000 déplacés. Pour juguler la montée de la violence, une poignée de développeurs et d’activistes kényans ripostent en créant Ushaidi, une plate-forme open source où les incidents sont répertoriés et dénoncés en temps réel.
La communauté internationale s’en mêle, et le massacre à huis clos est évité. Ushaidi (« témoigner », en swahili) va inspirer des centaines d’expériences similaires à travers le monde et ses fondateurs vont créer iHub, qui rassemble aujourd’hui plusieurs milliers de geeks.
Mais c’est en 2007 que le Kenya a fait sa première irruption sur la scène de l’innovation avec la naissance du service de paiement mobile M-Pesa. Pesa, en swahili, signifie « argent ». En avoir sur soi, lorsqu’on se promène dans les faubourgs de Nairobi, peut vous coûter la vie. M-Pesa, avec ses millions d’utilisateurs, a permis de « hacker » le problème : ce sont des SMS qui, en toute sécurité, vont transférer l’argent en quelques millisecondes, à un marchand, à votre famille.
A vrai dire, le concept fut d’abord élaboré dans les bureaux de Vodafone, au Royaume-Uni. Il n’empêche, la transition vers une économie sans cash, l’effacement progressif des discriminations bancaires, la normalisation de l’économie informelle, tout cela est en cours en Afrique et s’est même répandu au-delà du continent, en Afghanistan, en Inde et jusqu’en Europe de l’Est.
J’interroge Kenneth et son ami Sam Wakoba, qui dirige un magazine techno réputé au Kenya. Combien de start-up technologiques fondées au Kenya ? Ils hésitent. « Au minimum 500, sans doute beaucoup plus… C’est difficile à dire car beaucoup d’entrepreneurs abandonnent en cours de route, faute de financements. »
L’absence d’argent pour aider la prise de risques revient dans toutes mes discussions avec les start-up du continent. Afrique anglophone ou francophone, même galère. Premiers pointés du doigt : les Etats, désargentés, mal gouvernés ou simplement sourds et aveugles dès qu’il s’agit de soutenir leurs entrepreneurs.
Au Sénégal, la persévérance a fini par payer avec la naissance du premier fonds d’amorçage pour les start-up locales, Teranga Capital, réunissant des partenaires publics et privés. C’est le rêve de centaines d’entrepreneurs sénégalais, éternels éconduits des banques. De fait, en Afrique de l’Ouest, au Maghreb et ailleurs, deux, peut-être trois iHub sont sur le point d’éclore, avec des écosystèmes et des spécificités propres.
Combien de temps avant que les innovations numériques africaines, mises bout à bout, aient un impact tangible sur la création d’emplois et le PIB des pays africains ? Impossible à dire, mais s’il est une chose que j’ai apprise durant ces voyages, c’est que désormais, tout va plus vite en Afrique qu’on ne pouvait l’imaginer.
Samir Abdelkrim est le fondateur du site StartupBRICS.com et chroniqueur pour le Monde Afrique