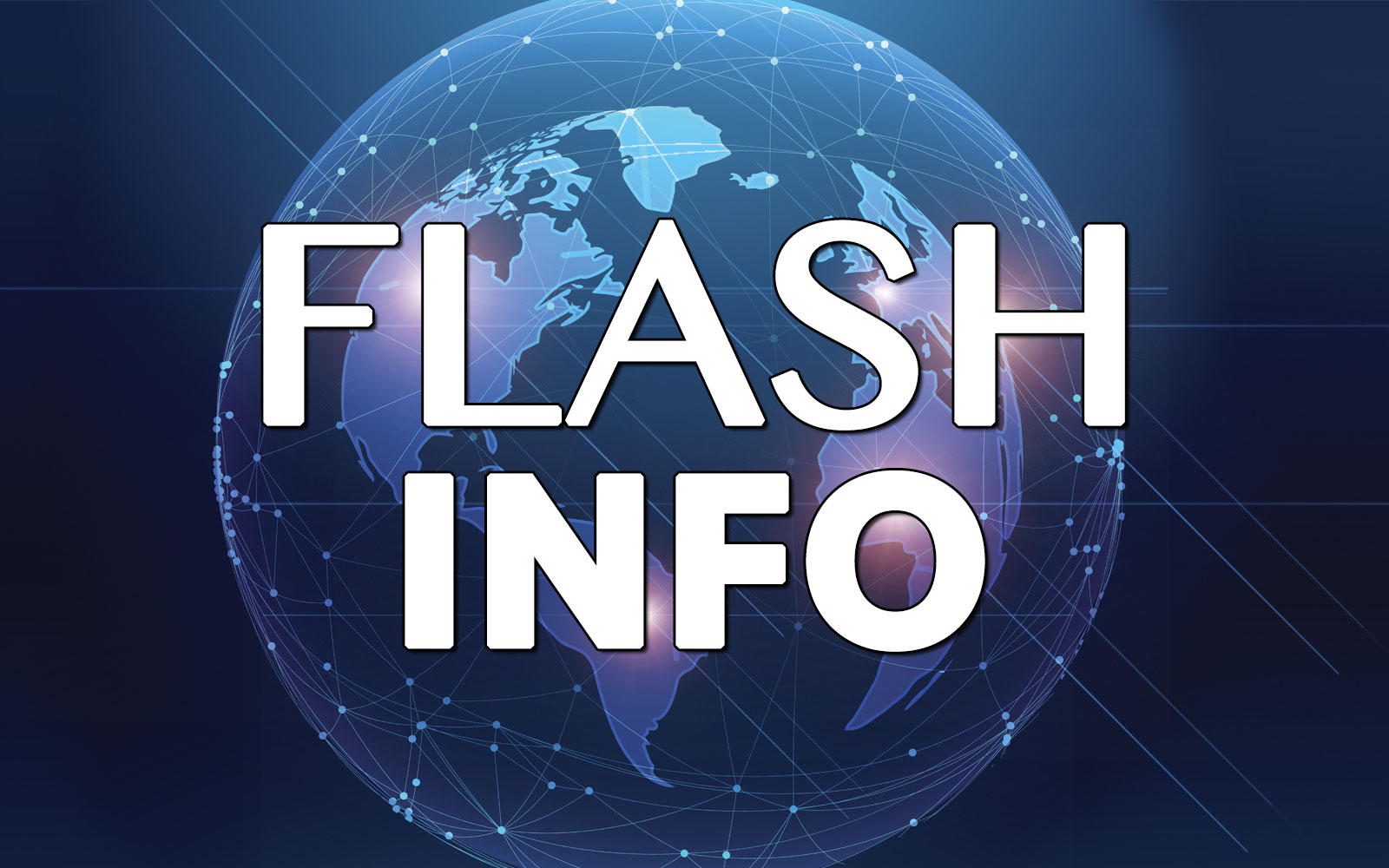Dominique Moïsi : « Le mot d’apartheid appliqué à Israël est problématique ».
TRIBUNE. Le géopolitologue français réagit à une tribune publiée dans « Le Monde » et qui qualifie de « crime d’apartheid » les « pratiques d’Israël ».
Par Dominique Moïsi*

Les mots sont des armes. Ils doivent être maniés avec précaution et discernement. Il y a des mots qui blessent, il y a des mots qui tuent ou qui, tout simplement, loin de contribuer à la résolution d’un problème, le rendent plus inextricable encore. Tel est le cas de l’expression « crime d’apartheid » récemment utilisée dans une tribune, publiée dans Le Monde, écrite par cinq anciens ministres des Affaires étrangères, à l’encontre de l’État d’Israël.
Le concept d’apartheid, tout comme celui d’Holocauste, décrit une réalité spécifique, temporelle et historique à nulle autre pareille. Le mot d’apartheid appliqué à Israël est problématique parce qu’il crée une confusion entre le traitement des Arabes israéliens en Israël, et celui des Palestiniens en Cisjordanie.
En Afrique du Sud au temps de l’apartheid, aucun « Noir » n’était président d’une des plus grandes banques du pays. Au temps de l’apartheid, les Noirs ne constituaient pas la moitié ou presque de l’équipe nationale de rugby.
Au temps de l’apartheid, Blancs et Noirs ne pouvaient étudier ensemble ou même se retrouver assis les uns à côté des autres sur une même plage. Au temps de l’apartheid, des médecins noirs ne soignaient pas des patients blancs dans le meilleur hôpital du pays.
En Israël aujourd’hui, c’est un Arabe israélien qui préside aux destinées de la Banque Leumi. Ce sont des Arabes israéliens qui constituent la moitié ou presque de l’équipe nationale de football du pays. Sur les plages de Tel-Aviv ou celles de la mer Morte, Arabes israéliens et Israéliens juifs sont côte à côte : il n’y a pas de plages réservées aux uns ou aux autres, même s’il est vrai que l’interaction entre les deux communautés est réduite au minimum.
Ce sont – je l’ai vu de mes propres yeux, à l’occasion d’un passage aux urgences ophtalmologiques de l’hôpital Hadassah à Jérusalem – des médecins israéliens qui soignent de jeunes enfants palestiniens et des médecins arabes israéliens qui soignent de très vieux survivants de la Shoah.
Ne vous méprenez pas sur mes propos. Dès le début des années 1970, j’ai été persuadé que l’avenir de l’État d’Israël passait par une solution juste et équitable du problème palestinien. J’ai participé comme témoin aux négociations sur le statut de Jérusalem dans le cadre du processus d’Oslo qui se sont tenues pendant quelque temps à Paris. Et je suis accablé par l’évolution politique d’Israël, mélange d’incohérence et de brutalité, dérive vers le populisme à la Netanyahou sinon, plus récemment encore, de basculement vers l’extrême droite « fascisante ». Ces évolutions sont non seulement une trahison des valeurs juives, mais sont contraires aux intérêts à long terme d’Israël. « C’est pire qu’un crime, c’est une faute », disait Talleyrand au lendemain de l’exécution du duc d’Enghien. J’ai rencontré récemment un jeune Français diplômé d’une prestigieuse école de management, qui venait de faire son alyah en Israël. Il entendait œuvrer de toutes ses forces pour une nouvelle relation entre Israéliens et Palestiniens. Ayant servi dans l’une des plus prestigieuses unités d’élite du pays, il me confiait qu’il ne voulait pas que ses enfants vivent ce qu’il avait lui-même vécu : à savoir imposer l’ordre et la sécurité dans les villages palestiniens en Cisjordanie. Devoir composer et à la fin s’incliner devant les diktats de colons toujours plus avides de terres palestiniennes, de plus en plus encouragés par les politiques au pouvoir, ce n’était pas pour lui, sioniste fervent, l’avenir qu’il souhaitait à ses enfants.