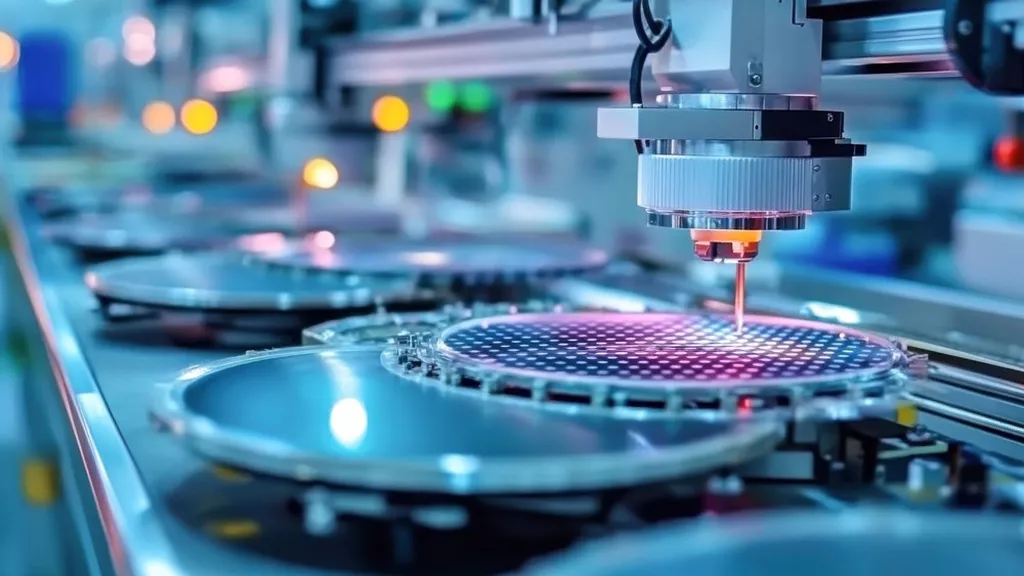Moshe Oren, directeur du centre intégré Moross pour la recherche sur le cancer à l’Institut Weizmann, en Israël, s’inscrit parmi les pionniers de l’étude du gène p53, l’un des plus déterminants dans le développement des tumeurs.
Le chercheur Moshe Oren (73 ans) a participé à l’isolement du gène p53 au début des années 1980, lorsque des scientifiques tels que l’espagnol Mariano Barbacid ont commencé à identifier les premiers gènes mutants liés au cancer. Dès le départ, il fut clair que ce gène jouait un rôle déterminant dans le développement de nombreuses tumeurs et, après des années de travaux, le p53 a été identifié comme « gardien du génome », chargé d’éviter le déséquilibre cellulaire à l’origine du cancer.
Les travaux d’Oren, qui a émigré en Israël pendant la décennie de 1950, ont contribué à la compréhension du rôle joué par la protéine p53 dans le maintien d’une croissance cellulaire normale. Les tumeurs apparaissent lorsque certaines cellules n’assument pas leur obsolescence programmée et qu’au lieu de mourir quand il y a lieu, elles continuent de se reproduire sans aucun contrôle. Souvent, pour cause, le p53 a muté et cesse donc d’exercer sa fonction de mise à mort des cellules selon le processus dit d’apoptose.
La description du cancer comme maladie génétique et des processus moléculaires à son origine a permis de mettre au point de nouvelles modalités de thérapies. Dans le monde, les principaux centres de recherche sur ces affections associent cette recherche en biologie fondamentale à la quête de solutions sur ce type de maladies. Actuellement, Oren dirige le centre intégré Moross pour la recherche sur le cancer à l’Institut Weizmann, en Israël. Cette institution multidisciplinaire cherche à fournir un éclairage sur le cancer en vue de le traiter. La semaine dernière, des chercheurs de cette entité et du Centre national de recherche sur le cancer (CNIO) se sont réunis au siège de la Fondation Ramon Areces, à Madrid. La rencontre organisée par les trois institutions visait à partager leurs avancées en matière de compréhension des mécanismes qui stimulent le cancer.
EL PAIS-. Depuis de nombreuses années, on sait que le cancer correspond à une pléthore de maladies, y compris qu’un même patient peut présenter plusieurs tumeurs. De ce fait, faut-il en déduire le besoin de combattre un nombre conséquent de maladies, à traiter séparément ? Ou peut-on espérer une certaine théorie de l’unification permettant de déceler des éléments communs pour simplifier les traitements du cancer ?
Moshe OREN -. Nous avançons dans cette direction. D’une part, nous disposons aujourd’hui des outils d’analyse de la complexité, qui, visiblement, augmente à mesure que nous les utilisons. Pour un même type de cancer, de nombreuses différences sont observées entre les patients, ainsi qu’entre les cellules tumorales d’un même sujet. Le défi consiste à regrouper toutes ces informations et à trouver des dénominateurs communs.
Il est impossible d’aboutir à un traitement unique du cancer. Cependant, nous ne souhaitons pas non plus avoir besoin, en définitive, d’un million de remèdes contre le cancer. De plus, nous ne pouvons préciser ces dénominateurs communs que si nous appréhendons la complexité, en procédant à des regroupements, et en identifiant les éléments communs à un groupe spécifique de mutations tumorales, pour ensuite trouver comment soigner les patients avec un nombre limité de traitements. Je pense qu’en définitive, nous allons pouvoir utiliser de manière intelligente un nombre restreint de traitements combinés.
Quels sont les obstacles à la réalisation de ces objectifs ?
Le principal défi à relever pour établir le lien entre nos connaissances et les actions qui sont à notre portée est lié, pour l’heure, à l’absence de traitements adéquats face à bon nombre des altérations présentes en cas de cancer.
Pour chaque patient, la tumeur peut désormais être analysée. Des entreprises et de grands centres médicaux offrent ce service. Ils examinent 100, 200, voire 300 gènes, et sont capables d’identifier des mutations connues pour leur rôle déterminant dans le développement du cancer. Cependant, pour la plupart de ces altérations, les traitements sont inexistants. Aussi, d’une part, nous voulons réduire nos déficits de connaissances et trouver des traitements pour plusieurs types de mutations. D’autre part, nous désirons déceler les implications biologiques communes à un groupe spécifique de mutations afin de prédire s’il réagira de manière sélective aux médicaments disponibles.
À mon avis, les efforts doivent se centrer, d’un côté, sur la mise au point de nouveaux médicaments, car il est clair que nous manquons de thérapies ciblées. Et d’un autre, nous voulons, en outre, tenir compte de cette multitude de données que nous produisons, qui indiquent que le cancer est notamment plus complexe que nous ne l’imaginions, qu’il ne s’agit pas d’une maladie, ni même de 300 maladies, et qu’il en constitue un spectre, un continuum. De plus, nous souhaitons exploiter cette complexité en faisant appel au deep learning (apprentissage profond), à l’intelligence artificielle, afin de la simplifier, puis fournir ces informations à l’hôpital pour administrer un traitement. Telle sera, à mon avis, la voie à suivre : identifier et comprendre la complexité au plus haut niveau, puis essayer de la simplifier en faveur de traitements pratiques, qui ne sont pas appliqués à l’infini.
L’intelligence artificielle est-elle déjà utilisée dans ce but ?
Oui, nous utilisons déjà l’intelligence artificielle pour extraire du sens des données qui se dégagent de nos recherches, pas seulement sur le cancer. Mais ce ne sont que les prémisses. Ces 10 dernières années ont été marquées par une étroite collaboration entre les experts en informatique et en données et les chercheurs axés sur le cancer. Ce sera l’une des pistes pour surmonter les obstacles. Un processus lent, qui va toutefois prendre beaucoup d’ampleur.
Pour combattre le cancer, faut-il obligatoirement comprendre tous les mécanismes qui le sous-tendent ? Ou peut-on continuer à chercher des solutions par tâtonnements successifs ?
Il n’est peut-être pas nécessaire de chercher à tout comprendre. Qu’est-ce que cela signifie ? Je l’ignore. C’est comme si on se proposait d’appréhender tout l’univers. En revanche, à mesure que notre compréhension s’améliorera, nous aurons plus de possibilités d’éviter les erreurs. Le problème est qu’au laboratoire, on a bien quelques idées : on prend 20 souris, on leur applique respectivement un traitement distinct, puis on effectue des comparaisons pour ensuite trouver le remède le plus efficace. Or, chez les humains, cette méthode n’est pas envisageable.
De nos jours, nous administrons une série de remèdes au patient lorsque, par malheur, il ne réagit pas au traitement de première ligne. Mais cette situation n’est pas idéale. Il faut donc accroître la probabilité que le traitement initial soit le meilleur qui soit disponible pour la personne concernée. Et c’est l’un des grands problèmes avec la thérapie du cancer, principalement constituée d’essais et d’erreurs. Notre compréhension est insuffisante, tout comme le nombre de biomarqueurs à notre disposition.
De mon point de vue, ce sont précisément ces biomarqueurs qui favoriseront la gestion de cette complexité. Nul besoin de tout comprendre : il faut avant tout disposer d’un groupe de biomarqueurs mesurables sur le patient et recourir au machine learning (apprentissage machine) pour traiter les informations. Les corrélations claires, lorsque nous les obtenons, sans nécessairement tout comprendre, nous permettent de déterminer si un patient va mieux réagir à un traitement spécifique.
Existe-t-il un risque que les nouveaux traitements du cancer soient très efficaces tout en restant inaccessibles à certains en raison de leur coût prohibitif ?
Cette question est très délicate. Le coût élevé de certains traitements résulte du montant de l’investissement associé à leur développement alors que pour d’autres, comme les CAR-T, il est lié directement à leur fabrication. Certaines thérapies du cancer disponibles sur le marché présentent un faible coût de production. Cependant, compte tenu des dépenses élevées de recherche et de développement, les entreprises veulent récupérer les investissements en pratiquant des prix fort conséquents. Pour moi, il s’agit d’une question éthique, mais aussi législative, qui est aussi liée aux politiques de santé, et pas uniquement à la recherche. Les gouvernements doivent trouver des solutions garantes de prix plus raisonnables. Cette préoccupation est essentielle.
Dernièrement, la recherche sur le vieillissement axée sur le traitement global de nombreuses maladies a le vent en poupe. Pensez-vous que ces travaux présenteront également un intérêt pour la lutte contre le cancer ?
C’est très simple : le vieillissement constitue le principal facteur de risque de cancer, auquel, en fin de compte, il ouvre la porte. À la base, notre corps et son évolution ne nous ont pas préparés à vivre jusqu’à 80 ou 90 ans, mais plutôt jusqu’à 30 ou 40 ans, pour produire la prochaine génération, puis disparaître. Ce laps de temps situé entre 40 et 80 ans nous expose progressivement aux maladies ; le cancer traduit d’ailleurs un accident associé à cette longévité. Une meilleure compréhension du vieillissement sera particulièrement utile pour réduire l’incidence du cancer. De plus, la recherche sur le vieillissement joue, per se, un rôle déterminant, car elle produit une série d’autres effets. Aussi, si nous parvenons à rendre le vieillissement moins symptomatique, nous en dégagerons une multitude de bénéfices.
Pensez-vous qu’un jour, le cancer va complètement disparaître ?
Je ne pense pas que nous soyons en mesure de faire disparaître le cancer. Il se distingue d’une maladie virale ou de la peste noire, pour lesquelles on fabrique un vaccin ou quelque chose qui va vous immuniser. Il n’existe pas un cancer, mais un éventail de types de cancer, ce qui me laisse penser que nous ne parviendrons pas à l’endiguer complètement. En revanche, nous pouvons atteindre un stade où la plupart des patients de cancer pourront mener une vie normale, moyennant un suivi analogue à celui d’une maladie chronique, comme dans le cas de l’hypertension. Selon moi, ce scénario est plus réaliste. Mon souhait est que le cancer soit totalement éliminé, mais j’ai le sentiment que c’est un vœu pieux.