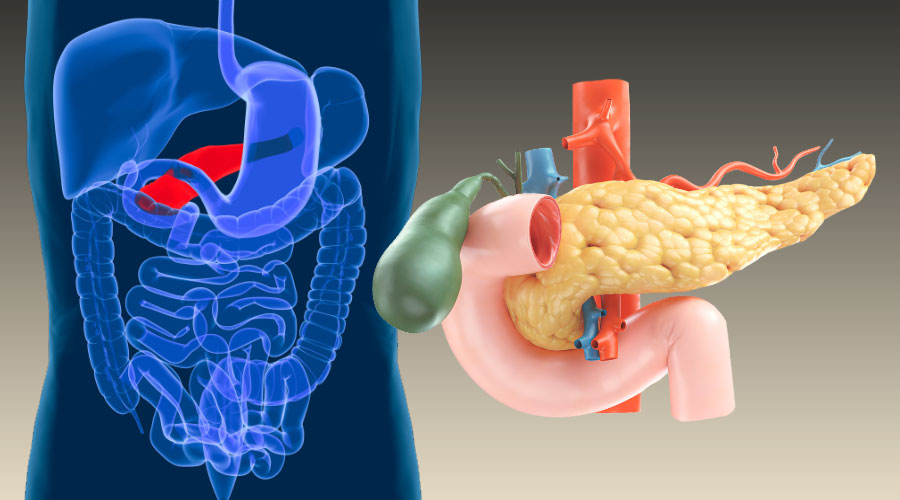ISRAELVALLEY EXCLUSIF. Du 28 au 31/07 se tient à Tel-Aviv (Hotel Dan Panorama) la conférence sur la médecine psychédélique. Les sponsors de cet évènement sont nombreux : Negev Labs, Atai, MAPS, Hadassah University Medical Center, Université de Haïfa, Israel Pain Association… IsraelValley a été très impressionné par la grande qualité scientifique des présentations.
LE PLUS. La thérapie psychédélique, parfois appelée psychothérapie assistée par les psychédéliques, est un type de psychothérapie qui implique le recours à des substances psychédéliques telles que la psilocybine, le LSD, le DMT, la mescaline, le 2C-B et la MDMA.
Des chercheurs tentent de soigner dépression et angoisse à l’aide de substances hallucinogènes. Ces drogues deviendront-elles des médicaments?

LSD, ecstasy, kétamine, champignons hallucinogènes… ces substances qui altèrent notre perception de la réalité sont plus connues comme drogues festives que comme médicaments. Et pourtant: des chercheurs, en Suisse et à l’étranger, les utilisent pour lutter contre diverses pathologies psychiques, allant de la dépression aux angoisses graves, en passant par le stress post-traumatique. Ils espèrent tirer parti des puissants effets de ces molécules sur le cerveau.
La kétamine est une de ces substances prometteuses. Déjà employée dans le domaine médical comme anesthésiant, elle est aussi utilisée à des fins récréatives, car elle altère le contact avec la réalité. Or des études publiées ces dernières années suggèrent qu’elle pourrait également soulager les dépressions profondes. «Elle a montré des effets positifs chez des patients qui ne répondaient pas aux antidépresseurs conventionnels, et elle agit plus rapidement que ceux-ci», indique le psychiatre Gerard Sanacora, de l’Université américaine Yale.
La kétamine tirerait son efficacité de son mode d’action: elle bloque en effet les récepteurs du cerveau sensibles au glutamate, tandis que les traitements classiques ciblent d’autres neuromédiateurs, tels que la sérotonine ou la noradrénaline. La voie empruntée par la kétamine aurait un effet plus direct sur l’humeur.
L’usage thérapeutique de cette substance reste cependant controversé, notamment en raison de ses effets hallucinogènes. «Nous considérons qu’il s’agit d’effets indésirables, car la plupart des patients ne souhaitent pas en faire l’expérience», indique Gerard Sanacora. Récemment, le médecin a donc testé une autre molécule, appelée lanicémine, dont le mode d’action est très proche de celui de la kétamine, mais qui n’entraîne pas d’altération de la perception. Lesrésultats, publiés en octobre dans la revue Molecular Psychiatry, montrent que la lanicémine est elle aussi efficace contre la dépression, mais qu’elle met plus longtemps à agir que la kétamine.
De son côté, le professeur David Nutt, de l’Imperial College de Londres, mise sur une autre substance hallucinogène pour soigner la dépression: la psilocybine, soit la substance active des champignons hallucinogènes. «Elle permet d’atténuer l’activité de certaines zones du cerveau qui sont hyperactives chez les personnes déprimées», indique le neuropharmacologue, qui commencera au début de l’année prochaine un essai clinique avec cette molécule.
Fervent partisan de la recherche sur les hallucinogènes, qu’il considère comme un des outils les plus puissants pour étudier le fonctionnement du cerveau, le Britannique aimerait également évaluer l’efficacité de la MDMA – c’est le nom scientifique de l’ecstasy – contre le syndrome de stress post-traumatique (PTSD). «Mais il est très difficile en tant que scientifique d’avoir accès à ces substances, qui font l’objet d’une régulation stricte en Grande Bretagne, à cause des fantasmes à propos de leur nocivité», s’agace David Nutt.
L’étude rêvée par ce scientifique a déjà eu lieu. Le psychiatre suisse Peter Oehen a en effet testé l’effet de la prise répétée d’ecstasy chez douze personnes souffrant de PTSD après une agression sexuelle. En parallèle, elles ont suivi une psychothérapie classique. L’étude étant menée sur un trop petit nombre de participants, les résultats publiés en début d’année dans la revue Journal of Psychopharmacology ne permettent pas de déterminer si l’approche est concluante. Les auteurs y relèvent toutefois qu’aucun de leurs patients n’a subi d’effet indésirable et que tous ont eu la sensation que leur état s’était amélioré.
Toujours en Suisse, un autre essai clinique récent a impliqué une substance psychédélique bien connue: le LSD. Synthétisée dans les années 1940 par le chimiste bâlois Albert Hofmann et popularisée vingt ans plus tard par le mouvement hippie, cette molécule est aujourd’hui illégale. L’étude menée à partir de 2007 par le psychiatre de Soleure Peter Gasser fut ainsi la première en 35 ans à se pencher sur son potentiel thérapeutique, en l’occurrence pour soulager des personnes souffrant d’anxiété sévère liée au diagnostic d’une maladie mortelle. «L’intérêt pour ces personnes est qu’elles ont besoin d’un traitement qui fasse effet rapidement, elles ne peuvent pas entamer une psychothérapie à long terme. L’expérience du LSD peut les ouvrir à d’autres réalités psychiques et ainsi les aider à surmonter une crise existentielle», estime le psychiatre.
L’étude, qui n’est pas encore publiée, portait également sur un petit nombre de patients. Mais Peter Gasser insiste d’ores et déjà sur le fait que son expérience s’est bien déroulée: les patients n’ont souffert ni d’anxiété sévère ni de pensées suicidaires, comme cela peut être redouté avec le LSD. «Notre expérience montre que cette substance peut être employée en toute sécurité dans des conditions contrôlées», avance le psychiatre, qui préside une association de médecins impliqués dans la recherche sur les hallucinogènes en Suisse.
Ailleurs dans le monde, d’autres scientifiques tentent de tirer profit des substances psychédéliques, par exemple pour traiter la migraine, ou encore pour lutter contre l’addiction à la cigarette. «Mais les recherches sur les hallucinogènes, qui ont connu un regain d’intérêt depuis une vingtaine d’années, demeurent un terrain d’étude modeste», affirme l’anthropologue Nicolas Langlitz, de la New School for Social Research à New York, qui a consacré un ouvrage à ce sujet, intitulé Neuropsychedelia (non traduit en français).
Dans ces conditions, comment imaginer l’avenir de ces recherches? «Il faudrait que les instituts publics de recherche se saisissent de cette problématique, car ils ont davantage de moyens et pourraient étudier un plus grand nombre de participants», avance Peter Gasser. Lui et son confrère Peter Oehen ont mené leurs recherches dans leur propre cabinet médical, grâce aux subsides d’une organisation américaine qui promeut la recherche sur les hallucinogènes.
De son côté, Thierry Buclin, responsable de la division de pharmacologie clinique au CHUV de Lausanne, voit un autre obstacle à cette approche thérapeutique: «Je n’ai aucun mal à croire que les substances hallucinogènes puissent avoir un intérêt dans le cadre d’une psychothérapie. Le problème, c’est qu’il est très difficile d’évaluer leur efficacité, notamment parce qu’elle dépend beaucoup de la compétence du thérapeute et de son interaction avec le patient.» Peter Gasser, qui possède des années d’expérience en recherche avec le LSD, reconnaît qu’il est nécessaire d’être correctement formé pour utiliser ces substances.
Reste la question des risques qui leur sont associés. «Il y a peu de danger de dépendance et on ne peut pas faire d’overdose avec les hallucinogènes, indique Rudolf Brenneisen, professeur de sciences pharmaceutiques à l’Université de Berne, qui mène lui-même des recherches sur le cannabis. En revanche, l’usage de ces substances peut servir de révélateur à une psychose préexistante.» D’après les spécialistes, il faudrait donc vérifier – dans la mesure du possible – que les personnes ne sont pas à risque avant de leur donner un traitement par hallucinogène. Celui-ci ne devrait par ailleurs être administré qu’au sein du cabinet médical, dans un environnement rassurant pour le patient. Autant de conditions qui pourraient compliquer le développement de la médecine psychédélique.
Les hallucinogènes ne devraient être administrés que dans le cadre du cabinet médical.